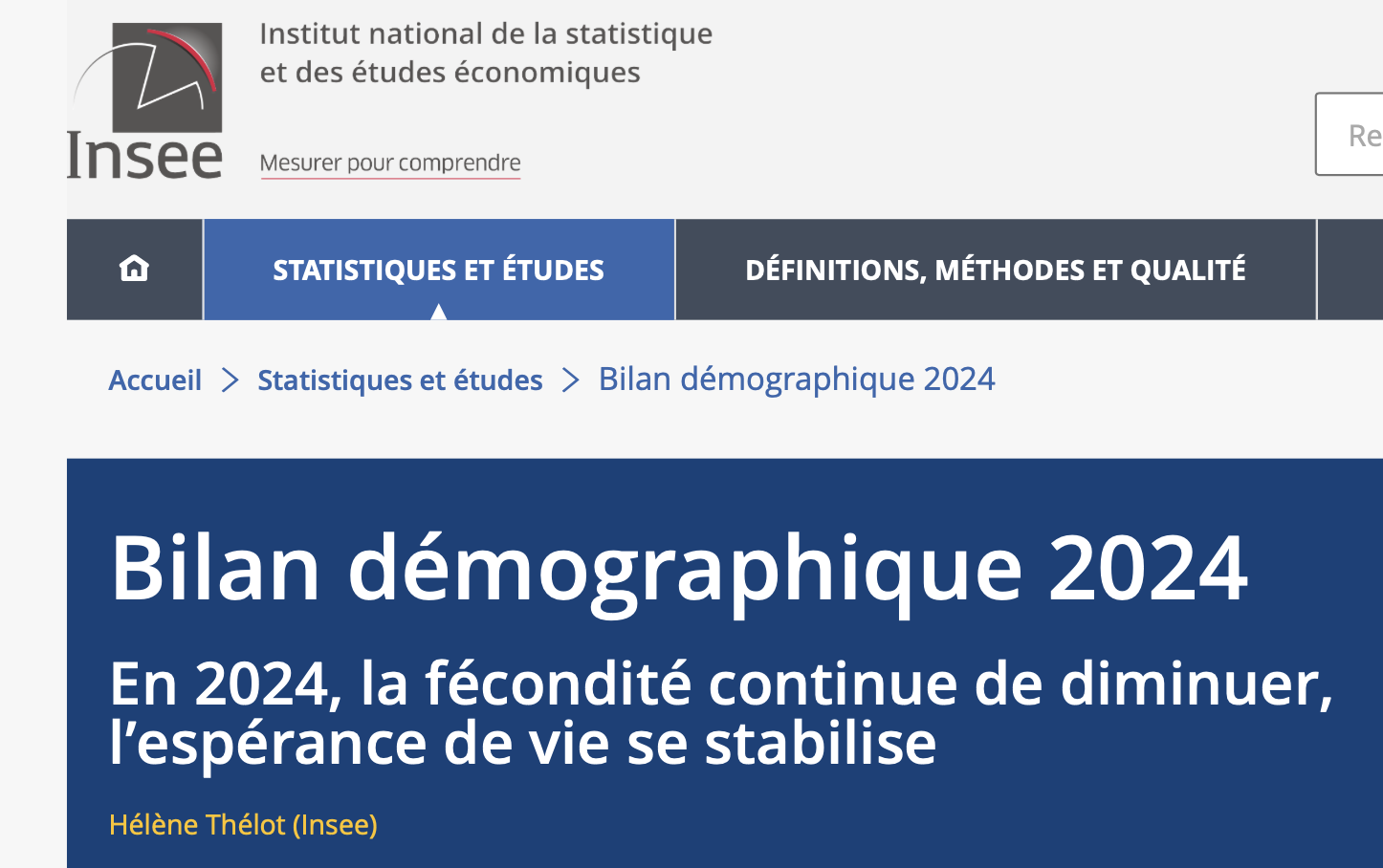Le dernier bilan démographique de l’Insee, publié en janvier 2025, met en évidence une baisse historique de la natalitéen France. En 2024, 663 000 bébés sont nés, soit 2,2 % de moins qu’en 2023 et plus de 21 % de moins qu’en 2010, année du dernier pic de naissances. L’indicateur conjoncturel de fécondité chute à 1,62 enfant par femme, son plus bas niveau depuis la fin de la Première Guerre mondiale.
Un solde naturel au plus bas depuis 1945
Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, s’établit à seulement +17 000 en 2024, un niveau historiquement bas. Si la population continue légèrement d’augmenter (+0,25 %), c’est principalement sous l’effet du solde migratoire. La baisse des naissances est donc structurelle, et s’explique surtout par le recul de la fécondité, plus que par une baisse du nombre de femmes en âge de procréer.
Les femmes continuent d’avoir des enfants plus tard : l’âge moyen à la maternité est désormais de 31,1 ans, contre 29,5 ans il y a vingt ans. Cette tendance reflète des choix individuels, mais aussi des réalités sociales, économiques et professionnelles qui pèsent de plus en plus sur les parcours reproductifs.
La parentalité sous tension dans le monde du travail
Ces données démographiques soulignent, en filigrane, les difficultés croissantes rencontrées par les personnes en âge de fonder une famille : précarité professionnelle, inégalités femmes-hommes, absence de politiques ambitieuses en matière de conciliation vie professionnelle/vie personnelle, invisibilisation de la santé reproductive dans les politiques de ressources humaines.
La décision de faire un enfant reste profondément intime, mais elle est aussi influencée par le contexte social et les conditions de travail. Stress chronique, fatigue, violences sexistes ou obstétricales, culpabilisation des mères au travail, discrimination à l’embauche ou au retour de congé maternité… Autant d’éléments qui peuvent peser sur la décision de devenir parent.
Be&Believe, un acteur engagé pour la santé reproductive au travail
Dans ce contexte, l’association Be&Believe, qui lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail, porte une attention particulière à la santé reproductive comme enjeu professionnel et sociétal.
Parmi ses engagements concrets figurent :
-
La sensibilisation des employeurs à la santé gynécologique et reproductive des femmes salariées,
-
La promotion d’environnements de travail inclusifs et bienveillants pour les personnes en parcours de parentalité,
-
La prise en compte des troubles hormonaux, des douleurs menstruelles ou des fausses couches dans les politiques internes de santé au travail,
-
La lutte contre les stéréotypes de genre qui pèsent sur les carrières des mères ou des femmes sans enfant.
Loin d’être une affaire privée, la santé reproductive est aussi une question d’égalité, de reconnaissance et de justice sociale.
Un défi collectif pour les années à venir
La baisse continue de la natalité ne peut être dissociée des conditions de vie et de travail des jeunes générations. Elle interroge les politiques publiques, les pratiques managériales, et les représentations sociales qui entourent la maternité, la parentalité et l’engagement professionnel.
Face à cette tendance lourde, il devient urgent de repenser le monde du travail à l’aune des parcours de vie réels, et de replacer les questions de santé reproductive au cœur des préoccupations sociales. Car favoriser la parentalité, ce n’est pas seulement relancer la natalité : c’est aussi garantir à chacun et chacune le droit de choisir sa vie, librement et dignement.