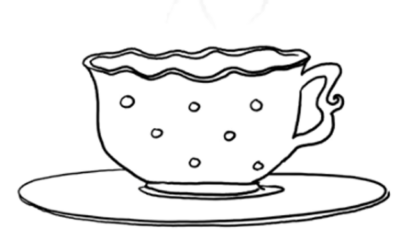Se former sans subir :
construire un savoir en toute sécurité
Se former, c’est grandir, découvrir, questionner. C’est un droit fondamental pour chaque étudiant, et cela ne devrait jamais se faire dans la peur, l’humiliation ou le silence. Pourtant, les violences, discriminations et formes de harcèlement dans l’enseignement supérieur restent une réalité préoccupante, aux conséquences graves sur la santé mentale, l’estime de soi et le parcours académique.
Chez Be&Believe, nous défendons une vision de la formation fondée sur le respect, l’écoute, la justice et la solidarité. Apprendre dans un cadre sécurisant, c’est permettre à chacun de s’épanouir, de prendre sa place, et de construire un avenir librement choisi.
Comprendre les mécanismes du harcèlement, identifier les facteurs de risque, libérer la parole et agir concrètement : autant d’étapes essentielles pour garantir un environnement d’étude sûr, bienveillant et engagé dans la lutte contre toutes les formes de violences.
Accordéon fermé
Définitions du harcèlement dans l'enseignement supérieur
Le harcèlement dans l’enseignement supérieur recouvre plusieurs formes de violences, qu’elles soient psychologiques, verbales ou comportementales. Ces agissements peuvent avoir des conséquences graves sur la santé mentale, le parcours académique et la vie sociale des étudiants, et concernent aussi bien les relations entre pairs que celles impliquant des rapports hiérarchiques, comme entre enseignants et étudiants.
Le harcèlement moral se caractérise par des comportements ou des propos répétés visant à détériorer les conditions d’étude ou de travail d’une personne. Il peut s’agir de dévalorisations constantes, d’isolement, de pression excessive, de critiques injustifiées ou d’humiliations, qui finissent par porter atteinte à la dignité de la personne ou à sa santé mentale et physique. Ce type de harcèlement peut s’installer insidieusement dans le quotidien universitaire et provoquer un mal-être profond, un repli sur soi, voire un décrochage scolaire.
Le harcèlement sexuel, quant à lui, désigne des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, qui portent atteinte à la dignité d’une personne ou créent un environnement intimidant, hostile ou offensant. Cela peut prendre la forme de gestes déplacés, de remarques insistantes sur le physique, de blagues sexistes ou encore de tentatives de chantage à connotation sexuelle. Dans certains cas, un seul acte peut suffire à constituer un harcèlement sexuel, s’il est particulièrement grave ou s’il implique une pression.
Ces comportements, qu’ils soient commis par un étudiant, un enseignant, un encadrant ou toute autre personne au sein de l’établissement, sont strictement interdits par la loi. Ils peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires(par l’université ou l’école), mais aussi à des poursuites pénales, dès lors qu’ils relèvent du Code pénal.
Face à ces situations, il est essentiel que les victimes puissent se repérer dans les définitions légales, identifier ce qu’elles vivent, et accéder à des dispositifs de signalement clairs, sécurisés et accompagnants.
La connaissance des droits, combinée à une tolérance zéro des établissements, est un levier indispensable pour lutter contre toutes les formes de harcèlement dans l’enseignement supérieur.
Chiffres clés sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur
Les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur constituent une réalité préoccupante, encore largement sous-estimée. Le Baromètre 2023 de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur met en lumière l’ampleur du phénomène, à travers des données saisissantes recueillies auprès des étudiant·es de tous horizons. Ces chiffres révèlent non seulement la fréquence des violences subies, mais aussi leur banalisation dans certains contextes universitaires, où l’impunité reste trop souvent la norme.
Selon cette enquête, près d’un étudiant sur dix déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son entrée dans l’enseignement supérieur. Ces agressions peuvent survenir dans les résidences étudiantes, lors de soirées universitaires, ou même dans l’enceinte même des établissements, où les rapports de pouvoir, le sexisme ordinaire et les silences institutionnels peuvent favoriser un climat d’impunité.
Par ailleurs, 6% des étudiants disent avoir été victimes ou témoins d’agression sexuelle au sein de leur établissement. Ce chiffre souligne à la fois la fréquence des violences, mais aussi la part non négligeable de la communauté universitaire qui en est témoin, souvent sans savoir comment réagir ou à qui s’adresser.
Les outrages sexistes – tels que les commentaires dégradants, les gestes obscènes ou les propos sexuellement connotés – sont également largement répandus : 14% des étudiants en déclarent avoir été victimes, et près de 30% en ont été témoins. Ces formes de violences dites « banales » sont pourtant profondément délétères et participent à l’installation d’un climat anxiogène pour les victimes.
Enfin, 1 étudiant sur 20 affirme avoir été victime de harcèlement sexuel, et 1 sur 10 en avoir été témoin. Ces chiffres confirment que le harcèlement sexuel ne se limite pas à des cas isolés mais s’inscrit dans des dynamiques systémiques, souvent minimisées par les institutions.
Ces données appellent une prise de conscience collective, un engagement fort des établissements d’enseignement supérieur, et la mise en place de dispositifs clairs et accessibles pour prévenir, signaler et accompagner les situations de violences.
Au-delà des chiffres, ce sont des parcours d’études brisés, des étudiants en souffrance et un sentiment d’insécurité qui ne devrait jamais avoir sa place dans un lieu d’apprentissage.
Impact sur la santé mentale des étudiants
Les violences sexistes et sexuelles, tout comme le harcèlement, ont des conséquences profondes et durables sur la santé mentale des étudiants.
Au-delà de l’impact immédiat de l’agression ou de la situation de harcèlement, c’est souvent dans la durée que les effets psychiques se manifestent, parfois de façon insidieuse et silencieuse. Pour beaucoup de jeunes, ces violences surviennent à une période charnière de construction de soi, où la vulnérabilité émotionnelle est déjà présente du fait des exigences académiques, de la précarité étudiante ou de l’éloignement du cadre familial.
L’exposition à des comportements violents ou dégradants peut entraîner l’apparition de troubles anxieux ou dépressifs, avec des répercussions sur l’estime de soi, le sentiment de sécurité, et la capacité à se projeter dans un avenir professionnel ou personnel. Certaines victimes développent des symptômes de stress post-traumatique, avec des manifestations telles que des troubles du sommeil, des reviviscences, une hypervigilance ou un évitement de certains lieux ou situations. Ces symptômes peuvent parfois persister plusieurs mois, voire années, après les faits.
Ces violences peuvent également engendrer une forme d’isolement social, souvent renforcée par la peur de ne pas être crue, le sentiment de honte, ou l’absence de réponse institutionnelle adaptée. De nombreux témoignages évoquent une perte de motivation, une difficulté à suivre les cours, à se concentrer ou à maintenir un rythme de travail. Pour certains étudiant·es, l’abandon des études devient alors la seule issue envisageable, faute de soutien ou de prise en charge adaptée.
Face à ces constats, il est indispensable que les établissements mettent en place des dispositifs accessibles d’écoute, d’accompagnement et de soutien psychologique. Les cellules de signalement doivent être visibles, formées et réactives, et les services de santé universitaires doivent pouvoir proposer des parcours de soins adaptés. Il est également essentiel de former les équipes pédagogiques et administratives à l’accueil de la parole des victimes, afin de ne pas aggraver leur souffrance par des réactions inappropriées ou des silences institutionnels.
Facteurs de risques de harcèlements dans l'enseignement supérieur
Certaines caractéristiques propres à l’enseignement supérieur contribuent à augmenter les risques d’exposition aux violences sexistes et sexuelles. Ces facteurs de risque, bien identifiés dans le rapport « Les violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur et la recherche », permettent de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre et d’agir de manière ciblée sur les environnements les plus à risque.
Parmi ces facteurs, la faible mixité constitue un élément déterminant. Dans les filières où l’un des genres est nettement majoritaire – qu’il s’agisse d’environnements très masculins comme certaines écoles d’ingénieurs, ou très féminins comme les filières paramédicales – des déséquilibres de représentation peuvent favoriser l’émergence de comportements sexistes, stéréotypés, voire hostiles. L’entre-soi, combiné à un manque de sensibilisation, peut créer un terrain propice aux propos déplacés, à la mise à l’écart ou à des violences plus graves.
Le statut précaire des étudiants est également un facteur aggravant. Les personnes confrontées à des difficultés financières, administratives ou sociales sont souvent dans une position de fragilité accrue. Cette vulnérabilité peut les empêcher de dénoncer les violences subies, de peur de perdre un logement en résidence universitaire, une bourse, ou tout simplement leur place dans l’établissement. De manière plus générale, les étudiants précaires disposent souvent de moins de ressources pour se défendre, se protéger ou accéder à un accompagnement psychologique et juridique.
Enfin, la culture institutionnelle joue un rôle majeur. Dans certains établissements, une tolérance implicite à des comportements sexistes, des blagues graveleuses banalisées ou un flou autour des procédures de signalement entretiennent un climat d’impunité. L’absence de politique claire de prévention et de formation, tant pour les étudiant·es que pour les personnels, contribue à invisibiliser les violences et à décourager la parole des victimes.
La combinaison de ces facteurs souligne la nécessité d’une vigilance constante et d’une action systémique. Identifier les contextes à risque ne revient pas à stigmatiser certaines filières ou établissements, mais bien à adapter les actions de prévention et les dispositifs de protection en fonction des réalités de terrain, afin de garantir à chaque étudiant un cadre d’étude sécurisé, respectueux et égalitaire.
Nos projets
Chez Be&Believe, nous sommes engagées dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les harcèlements dans l’enseignement supérieur. Nos actions incluent :
- Collaboration avec l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) : nos cofondatrices, le Pr Florence Boitrelle et le Dt Marion Bendayan, sont référentes pour la lutte contre les violences au sein de l’UVSQ. Elles participent activement au déploiement d’un modèle d’action de prévention et de sensibilisation dans chaque composante de l’université, ainsi qu’au développement de moyens de détection et d’intervention.
- Publication à venir : Nous préparons la sortie prochaine d’un livre abordant les violences sexuelles et sexistes, afin de sensibiliser et d’informer sur ces enjeux cruciaux.
Nous croyons fermement que l’éducation et la prévention sont essentielles pour créer des environnements d’apprentissage sûrs et respectueux pour tous.
Actualités
Et si on prenait exemple sur Londres ?
Aux yeux du Premier ministre Britannique , nous devons adopter une approche en trois volets impliquant « l'ensemble de la société et l'ensemble du gouvernement » avec une prévention proactive, poursuite des auteurs et soutien aux victimes... Et si on faisait pareil...
Mister France – Lorraine 2025 Son combat contre les violences sexuelles et sexistes
William Sapin, Mister France -Lorraine 2025 - Lutter contre Les violences sexuelles et sexistes Étudiant en médecine et engagé contre les violences sexistes et sexuelles, je porte cette cause parce qu’elle fait profondément écho à mon parcours et à mes valeurs...
C’est la Rentrée : Accompagner les étudiants victimes de violences
La Cnaé : un guichet national pour le bien-être étudiant https://www.etudiant.gouv.fr/fr/cnae Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Coordination nationale d’accompagnement des étudiantes et des étudiants (Cnaé) offre un service...
Rencontre au ministère de l’égalité : une écoute attentive, des valeurs partagées
Ce mardi 27 mai 2025, nos présidentes Florence Boitrelle et Marion Bendayan ont été reçues avec Déborah Schouhmann Antonio au ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations par Madame Yaëlle Reynaud, conseillère...
Violences sexistes et sexuelles en santé : Be&Believe soutient le plan d’actions du ministère
Le 17 janvier 2025, en déplacement aux Hospices Civils de Lyon, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, a annoncé un plan d’actions national pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le secteur de la santé. Face à...
Le consentement : Vers une meilleure définition pénale des agressions sexuelles
Afin de renforcer son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), Be&Believe tente d’expliquer ce qu’est le consentement . En utilisant en formation des images simples, comme celle de la tasse de thé et en réalisant une veille...